|
LA MISSION DU LM
La véritable vie du LM ne commence qu' à la
117 eme minute de vol après le départ du lanceur Saturn 5 du centre spatial
Kennedy. Logé dans la partie tronconique qui prolonge le troisième étage S4B
au module de service SM Apollo, il attend qu'Apollo viennent le chercher ! Ce
dernier se détache du S4B et s'éloignant d'une soixantaine de mètres,
réalise une rotation de 180° sur lui même. Les quatre pétales du SLA (nom de
la structure tronconique) se séparent découvrant replié sur lui même le LM.
Manoeuvrant avec d'infimes précautions, le pilote du CM s'approche du LM à 0,3
m-s et s'y amarre solidement. Nous sommes à 2 h 21 mn de vol.
Les connections établies et vérifiées, le
LM est extrait de son cocon, abandonnant l'étage à son sort. Sur les 2850
tonnes du départ, le nouveau couple CSM LM ne pèse que 45 tonnes et vole
maintenant vers la lune à 40 000 km-h.
La mise sur orbite lunaire est réalisée par
le moteur SPS du module de service un peu plus de 60 h après le départ.
L'équipement du LM est vérifié par ses occupants, le pilote et le comandant
du vol. Si quelques choses ne marchait pas, il serait toujours temps de remettre
à feu le module de service et revenir vers la terre.
| Le
CSM et LM assemblé sont maintenant sur orbite lunaire. Le CSM va rester
sur orbite tandis que le Lm occupé par deux astronautes va s'en détacher
et atterrir sur le sol. Le CSM continuera de tourner autour de la lune
pendant que le LM sera sur le sol lunaire.

1 Le CM et le LM sont
amarrés à une altitude de 110 km de la lune
2. Les deux vaisseaux se
détachent doucement et commencent la séquence de descente vers la lune.
Une manoeuvre du LM permet au pilote du Cm de l'inspecter visuellement
avant la descente.
3. Afin de rester à
bonne distance du LM, le CSM s'en éloigne et se met sur une orbite
différente laissant le LM seul. Leur trajectoire est telle qu'en cas de
problème, les deux vaisseaux pourront à nouveau s'attacher ensemble au
bout d'une orbite.
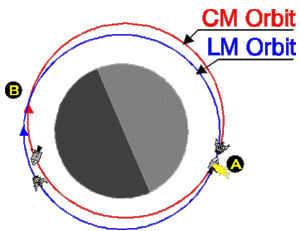
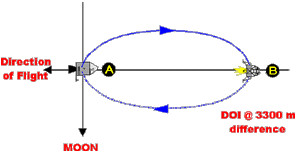
Position
relative du LM et du CSM. La ligne noire horizontale indique l'altitude
orbitale du CM et l'ellipse bleu la dérive relative du LM. Il va de A
vers B et revient en A en cas de problème avec le moteur du LM. Sur le
dessin de gauche, en A nous voyons le LM aller sur une orbite plus haute,
le CSm sur une orbite plus basse. En B les orbites se croissent, le LM va
vers son périgée, le CSM vers son apogée. Ce sont les mêmes orbites en
altitude mais elles sont décalées
4. Le LM est prêt à
descente vers la lune et allume son moteur afin d'abaisser le périgée de
son orbite à 14,5 km.
5. Arrivée au périgée
108 minutes plus tard, le LM freine avec son moteur réduisant sa vitesse et son
altitude jusqu'a se poser doucement sur le sol lunaire. Cette phase de
pilote est la plus exitante du vol, l'homme étant au commande et décide
lui seul de se poser ou de remonter vers le CSM. Contrôlant leur descente
avec les indicateurs de vitesse, l'équipage manoeuvre le LM avec les
moteurs RCS afin de stabiliser la trajectoire. Le contrôle de la poussée
du moteur de descente permet au LM de réaliser de véritables "rases
motte" au dessus du sol afin de cherchant précisément le meilleur
point d'atterrissage. Des tiges "contact" de 1 m de long situé
sous les assiettes des jambes du LM signalent aux astronautes par une
lumière qu'il faut couper le moteur de descente et laisser le LM se poser
sur le sol à la vitesse de 2,8 m-s.
|
La remonté du LM est peu être la phase la
plus délicate du vol. Il s'agit de réaliser un rendez vous en orbite lunaire
avec le CSM qui tourne au dessus de la lune à 110 km d'altitude. C'est l'étage
de descente du LM qui sert de rampe de lancement pour l'étage de remonté.
L'allumage du moteur à ergols hypergolique est d'une simplicité extrême, le
cas échéant, les astronautes peuvent le faire démarrer grâce à deux fils !
| Plusieurs
manoeuvres sont nécessaires au LM pour réussir un rendez-vous avec le
CSM. Plutôt que de courir le risque de tenter un seul allumage du moteur
de l'étage supérieur pour se placer en orbite de rendez-vous direct avec
le CSM, ce ballet orbital est composé de plusieurs étapes, chacune
d'entre elles permettant d'ajuster progressivement les divers paramètres
orbitaux du LM. La conception de base des procédures de rendez-vous est
structurée non seulement dans un souci d'efficacité en termes de
consommation de carburant (en se souvenant des marges très serrées du
LM) mais aussi pour minimiser les conséquences de petites erreurs de vélocité.
Trop ou trop peu de combustion du moteur de remontée pourrait faire se
manquer les deux vaisseaux, et sur de grandes distances. Deux méthodes de
rendez-vous ont été développées et utilisées au cours d'Apollo. La
première, le rendez-vous coelliptique, utilisa les expériences acquises
au cours de Gemini pour Apollo 9, 10, 11 et 12. Commençant avec Apollo 14
et se poursuivant jusqu'à la fin du programme Apollo, l'expérience antérieurement
acquise permit d'utiliser une variante connue sous le nom de rendez-vous
direct.
Les
deux méthodes étaient conçues pour amener le LM en un point spécifique
de l'espace avec le CSM en avant et au-dessus, avec une marge serrée en
termes de géométrie relative et d'éclairage. Arriver à ce point au bon
moment et à la bonne vitesse, c'est à dire là où la très importante
phase terminale devait commencer, était le but. La méthode coelliptique
reflète le conservatisme en vigueur pour la première conception de la
mission. Sacrifiant au prompt retour de l'équipage du LM au CSM, les
premières missions Apollo ont nécessité une séquence méthodiquement
constituée d'une orbite et deux allumages pour en arriver à la phase
terminale, en faisant correspondre l'altitude et le plan orbital des deux
vaisseaux. A partir de ces missions, des renseignements suffisants furent
recueillis sur la performance et la capacité du vaisseau spatial pour
supprimer deux manoeuvres principales nécessitant une charge de travail
intensive. Connue sous le nom de méthode directe, la phase terminale
pourrait maintenant commencer peu de temps après le décollage de la
surface lunaire avec un arrimage réalisé moins d'une orbite plus tard.
METHODE
COELLIPTIQUE
Le but
de la méthode coelliptique était de façonner un modèle classique de
mission, défini par la phase terminale standard désignée ci-avant,
ainsi que de réduire les effets de variations du moteur, du guidage et
des autres systèmes (communément appelés "dispersions"), et
de fournir un certain nombre d'options d'annulation et de secours pour le
cas où le LM était dans l'incapacité d'accomplir toutes ses manoeuvres.
Nécessitant 3 heures et demi et pratiquement deux orbites, la méthode
coelliptique donnait un délai suffisant aux équipages pour contrôler
leur progression, vérifier la similitude entre les données radar et
visuelles, obtenir des mises à jour actualisées de la Terre et vérifier
la performance des systèmes.
Bien
qu'habituellement appelé le véhicule "passif", la charge de
travail à bord du CSM était tout sauf inexistante. Parce qu'il lui
allait peut-être être nécessaire de secourir le LM en cas de défaillance
d'un quelconque de ses systèmes, le pilote du module de commande mettait
constamment à jour son propre ordinateur avec la position et la vitesse
du LM. De tels contrôles constituaient également une vérification des
solutions calculées à la fois sur Terre et à bord du LM. Le maintien
d'une orbite circulaire (à 110 km) pendant le rendez-vous simplifiait
grandement les procédures et plaçait le CSM dans une position optimale
pour toutes les manoeuvres de secours possibles.
RENDEZ
VOUS DIRECT
Forte
de l'expérience du rendez-vous (et aussi d'une confiance accrue dans les
systèmes), la NASA va mettre en oeuvre une autre méthode dénommée le
rendez-vous direct. Débutant avec Apollo 14, et utilisée pour
toutes les missions postérieures, cette nouvelle méthode demande moins
de deux heures et moins d'une orbite pour être réalisée. Il est permis
de dire que le rendez-vous direct est identique à la méthode
coelliptique en en supprimant toutes les phases non indispensables. Il
convient de rappeler que la technique coelliptique avait été conçue
dans l'hypothèse où plusieurs corrections orbitales étaient nécessaires
et que d'importantes mises à jour (vitesse, position, distance,...) étaient
indispensables à une navigation précise. En éliminant deux manoeuvres
(CSI - Coelliptic Sequence Initiation et CDH -Constant Delta Height), et
en exécutant la manoeuvre TPI tout de suite après l'insertion en orbite,
le rendez-vous des deux vaisseaux était terminé.
|
Aidé par le radar de rendez vous, l'étage de
remonté s'élevé rapidement du sol sous la poussée de son moteur de 1600 kg.
Suivant une trajectoire balistique, il s'incline pour se mettre sur une orbite
de transfert avec le CSM. A coup d'impulsion, le LM se rapproche du CSM plus de
deux après son départ de la lune. Aidé par le calculateur de bord, le radar
et leur vue, les deux équipages manoeuvrent jusqu'à l'amarrage une demi heures
plus tard. Les liaisons mécaniques et la pression vérifié, les deux
astronautes vont pouvoir passer dans le CM avec leur précieux chargement de
pierres lunaire.
Avant d'être abandonner sur orbite ou
simplement crashé sur le sol, l'étage de remonté sert de "poubelle"
pour les astronautes. Y sont laissés les casques EVA, les équipements dorsaux
de survie, les bottes et tout ce qui ne sert plus à rien pour le reste du
vol.
Allégé, le CSM conduit seul les trois
astronautes vers la terre qu'il atteindront d'ici quelques jours.
|
