|
LES PC DE TIR
Les missiles étaient surveillés nuit et
jour et commandés à distance à partir de 2 Postes de Conduite de Tir (PCT),
construits sous terre, à 400 m de profondeur. Chaque poste de tir avait en
charge 9 zones de lancement. Le premier au Nord, PCT 2 se trouve dans la Drôme près de
Reilhannette et l'autre au Sud, PCT 1 dans le Vaucluse près de Rustrel,
à 30 km l'un de l'autre. Véritables bunkers dissimulés sous plusieurs
centaines de mètres de roche, les PCT ont été conçus non seulement pour
résister à toute attaque nucléaire, mais aussi pour éviter toute
intrusion grâce à de longues galeries à angles droit de près de 2 km de long. Les travaux du PCT 1
ont duré deux
ans de novembre 1966 à mars 1969, 74 000 m3 de roches sont
extraites, 40 000 m3 de béton coulé et 1200 tonnes de fer amenés. Le chantier du PCT 2 a démarré
en juillet 1969 pour se terminer en mars 1970. 94 500 m3 de roches
sont extraites, 46 000 tonnes de béton coulés et 1380 tonnes de fer
amenés.

L'entrée du PCT 1 de
Rustrel


L'entrée du PCT 2 de Reilhanette

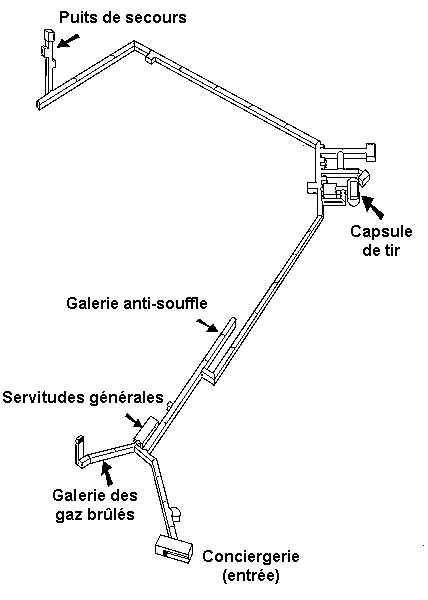 |
Le PCT,
Poste de Conduite de Tir.
Enterré sous la roche à plus de
500 m de profondeur, les postes de tir étaient complètement isolé
de la surface. La partie visible se composait d'une immense
plateforme bétonnée grande comme un demi terrain de football
entièrement clôturée et d'un fronton en béton long de 30 m sur
5 de hauteur. Une première clôture délimitait le site sur la
montagne, une seconde électrifiée délimitait la plateforme avec
un sas à double portail donnant accès à la conciergerie.
Le fronton épais de 2 m était
équipé de caméras et d'une porte blindée contre les tirs de
roquettes. Une "casquette" assurait l'entrée d'air
nécessaire à la ventilation du site.
Une porte
métallique protégeait la conciergerie, une sorte de hall
d'entrée, grand comme une salle de squash (41 x 17 m sur 6 m de
hauteur) avec ses murs de béton
brut, d'une propreté parfaite. Si le "concierge", à
l'abri derrière une glace sans tain donnait son autorisation, il
ouvrait une porte blindée donnant accès fameux long tunnel vers
le poste de tir.
|
|
Ce tunnel, de 6 m de diamètre est
comme une route, bordé de trottoir. D'ailleurs on y circule en
voiturettes électriques. Entièrement éclairé, il monte dans
la montagne sur près de 2 km. Première bifurcation à 350 m vers
la galerie des gaz brûlés, ainsi nommé car elle permet
l'évacuation des gaz consécutif à une explosion nucléaire
devant le PCT. Après passage devant les servitudes générales,
creusées dans la roche (46 m de long, 9 m de large et 7 m de
hauteur) on arrive 437 m plus loin à la galerie "anti
souffle". C'est une sorte de "chicane" de 200 m qui
permet d'éviter la propagation du souffle d'une éventuelle
explosion nucléaire devant le poste de tir. En tournant à
droite, on se dirige 260 m plus loin vers la capsule de tir. 10 personnes se relayant 24 heures sur
24 travaillent dans le PCT,
deux mécanos et 6 commandos chargés de la sécurité et les deux
officiers de tir.
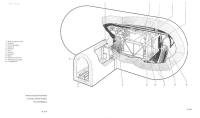
On la nomme capsule parce que c'est
une pièce qui a la forme d'une capsule de médicament, grosse
comme une carlingue d'Airbus. Le poste de tir occupe la moitié
gauche du cylindre long de 25 m environ. Deux stations sont
installées face à la paroi latérale, distantes de 4 m l'une de
l'autre, l'ordre de tir devant être simultanée et en 2
exemplaires. Les deux officiers, lieutenants ou capitaines,
pilotes ou ingénieurs sont volontaires pour leur missions,
relayer les ordres venus d'en haut après vérifications sans se
poser de questions. Ils travaillent 24 heures d'affilé assis dans
des fauteuils de dentiste devant des consoles et des écrans
contrôlant l'état des 18 missiles répartis autour d'eux au
dessus de leur tête. 20 officiers de tir assuraient par
rotation la "garde" des PCT. D'abord affectés dans
l'une des deux escadres d'hélicoptères "Lubéron"
pendant 3 ans, ils étaient formés pendant 3 mois et demi avec 8
semaines de théorie, 25 séances de simulateurs avant d'obtenir
leur licence opérationnelle d'officier de tir. 10 mois après,
ils obtenaient le brevet de chef de quart de capsule de tir.
Chaque équipe passait au simulateur avant d'être mis à poste.



Cette salle
n'est pas comme les autres, elle est montée, suspendue sur des
ressorts amortisseurs au sein d'une caverne artificielle creusée
à même la roche. La caverne (8 m de diamètre, 28 m de long)
recouverte de 2 m de béton est entièrement tapissée d'un acier
spécial, dont les feuilles sont soudées selon des procédés
spéciaux afin d'obtenir une cage de faraday aussi parfaite que
possible.
Après la capsule de tir, un
dernier long tunnel de 1800 m menant au puit de secours,
fonctionnant sur le principe des galeries Égyptiennes. Sur trois
niveaux, des tonnes de sables obstrue le passage vers
l'extérieur. Pour se sauver, les
officiers devaient monter à une échelle, ouvrir la trappe
libérant un premier tas de sables avant de continuer leur monté
à travers deux autres "piéges" du même type.
|
La transmission
des informations télésignalisations, télécommandes, ordres entre les
zones de lancement et le PCT étaient réalisées grâce à un réseau
filaire couvrant toute la zone de déploiement. Contrairement à ce qu'on
a pu penser, nul souterrain entre les ZL. Si un PCT ne pouvait assurer les
liaisons avec ses ZL, l'autre prenait le relais contrôlant les 18 ZL. Bien
évidement, ces centaines de kilomètres de fils, câbles étaient
constamment surveillés par les commandos de l'air de l'Escadron de
Protection 21/200, appuyés par des patrouilles au sol, à pied, à cheval
et en l'air par des hélicoptères. Chaque "anomalies"
(coupures, intrusion) étaient signalé au PCT.
En secours, la transmission
était assurée par onde de sol, même en cas d'explosion nucléaire.
Chaque PCT était équipé d'antenne TOS longues de plusieurs centaines de
mètres disposées sous les trottoirs des galeries principales. Chaque ZL
était équipé d'antenne de réception enterré dans le sol et relié à
l'intérieur du silo au niveau -6m.
La transmission des ordres
depuis l'Elysée au PCT était assuré par 6 systèmes redondant.
Le réseau "Tigre", téléphonique et télégraphique utilisant
le réseau de France Télécom et les relais hertzien de l'armée. Le
réseau Vestale spécifique au SSBS utilisant les ondes troposphériques (basse atmosphère) et hertziennes. L'ordre part de Paris de la
présidence à l'Elysée. Il est relayé par Taverny (COFAS), en région
parisienne et par le Mont Verdun au dessus de Lyon. Deux relais de réception d'ondes
troposphérique
réceptionnent l'ordre sur le mont Ventoux, T1 à 1500 m d'altitude au pas de la Frache
et T2 à 1830 m au col des Tempêtes au sommet de la montagne. Comme pour les PCT et les ZL, les installations
pouvaient résister à une explosion nucléaire. Le bétonnage de ces
sites fut une entreprise délicate et difficile de par leur accès.


T2 et T1
Dernier relais de
transmission, vers les PCT, les sites V pour "vertical". Situés à 450 m de
hauteur, à
l'aplomb des capsules de tir des PCT, les
antennes de réception V1 et V2 sont à vue directe des terminaux T1 et T2. V2 culmine à
1030 m au pied du mont Ventoux et V1 à 1212 m au dessus de Rustrel au Sud.



Vue des antennes sous
les dômes et bétonnage des sites
Verticaux.


V1 et V2
Aux systèmes Tigre et Vestale étaient
associés le réseau de la Marine nationale, le réseau ASTARTE par avion
C160 et le réseau graphie phonie RAMES (Réseau amont maillé stratégique
et de survie). Ultime réseau, la
télévision par les émetteurs de TDF.
Le problème pour l’armement français
est d’un coté le déséquilibre entre les forces nucléaires et
conventionnelles et d’un autre coté les coûts immenses pour des projet
de défense. En améliorant la force de frappe, la France a dépensé
tellement d’argent qu’il n’en reste pas assez pour les forces
conventionnelles - comme les chars et les avions modernes.
Quel sera l'avenir de l'armement français ? Peut être la coopération
avec d'autres pays dans la construction de nouvelles armes comme en
témoigne l’Eurofighter ou alors peut être dans un système de défense
s’inscrivant dans la communauté Européenne, une idée qui sera très
longue à réaliser.
|
