|
3 janvier, la campagne de
lancement V164 redémarre, elle avait été interrompue en octobre 2004 pour
préparer V165. Une troisième RSL est prévue le 12. Les clients satellite reviennent le 19 et Arianespace vise un lancement de A5ECA à partir du 11 février.
Pour 2005, Arianespace vise 5 à
6 lancements d'Ariane 5 dont le plus gros satcom du monde IPSTAR (allias Thaicom
4, 87 répondeurs en bandes Ku et 10 en Ka, 6735 kg) et l'ATV en fin d'année
avec la première Ariane 5 EVS (2 EAP P241, étage EPC H173 à moteur Vulcain-2
et étage EPS-V L10 à moteur Aestus).
L'année 2004 a terminé en beauté pour la société chargée de commercialiser
Ariane 5 avec la signature de 5 nouveaux contrats de lancement, pour Skynet 5A
et Skynet 5B (satcom militaire pour le compte du groupe européen EADS Astrium),
Corot (satellite d'observation stellaire) pour le CNES et deux Pléiades
(satellites d'observation de la terre) pour le CNES également. Les Skynet seront
lancés en 2006 et 2007 par Ariane 5, Corot par Soyouz 2.1B en 2006 (Baikonour)
et Pleiades par Soyouz 2 1B de Kourou en 2008-2009. Au total, Arianespace aura
ainsi remporté 12 contrats de lancement de satellites en 2004, 8 pour Ariane et
4 pour Soyouz. La société a ainsi un carnet de commandes de 40 satellites à lancer contre 33 il y a un an.
|
Quel est l'avenir d'Ariane ? La
question mérite d'être posée après une année 2004 où Arianespace qui gère les
lancements du lanceur Ariane 5 n'a pu réaliser que 3 tirs et dans la version
générique. Si les commandes ne se pressent pas ou sont simplement ventilées
artificiellement par des accords avec le Japon et ILS, il y a peu être des
questions à se poser. Si Ariane 4 fut un lanceur rentable économiquement avec
une cadence de tir très élevée pendant plus de 15 ans, c'est grâce à la navette
US, qui après l'accident de Challenger en 1986 a perdu le marché des satcoms.
Pour Ariane 5, il en est autrement. Ce lanceur a été conçue principalement pour
l'avion spatial Hermes. Dans la version commerciale, sa capacité devait
permettre de répondre à l'augmentation de masse des satcoms, en maintenant la
politique des lancements double. Le coût total du programme Ariane 5 est de 10
milliard d'euros, contre 13 pour Ariane 4. Le prix d'un lancement de satcom de
4500 kg est évalué à 55 millions $. Avec Ariane 5, en lancement double, le prix
devrait être de 110 millions $. Hors un lanceur du lot PA coûte 136 millions $.
La différence est actuellement compensée par le programme de l'ESA EGAS jusqu'en
2009. A partir de cette date, Ariane 5 se devra d'être "économiquement rentable"
pour Arianespace.
Y a t'il une alternative ? L'arrivée
du petit lanceur Vega dont le marché reste toutefois incertain et du Soyouz
russe qu'il va bien falloir rentabiliser, pose effectivement la question de la
pérennité d'Ariane 5 ou sa succession. Le
Soyouz doit être lancé dès 2006-2007
de Guyane. Les 223 millions d'Euros déboursés par l'ESA devront être
"rentabiliser" dans les 10 ans qui suivront. Ariane 5 sera t'elle "débarquée"
vers 2009-2010 quand Soyouz sera pleinement opérationnel et que l'Europe aura
acquis un accès entier à l'espace, notamment habité ? Avec Soyouz, la capacité
orbitale de l'Europe sera de 2900 à 3200 kg en GTO, très insuffisant pour les
gros satcoms (5000 kg) et certaines applications militaires. Le problème sera de
voir si le marché de ces gros satellites en vaudra le coup et de la voir un
successeur éventuel à Ariane 5.
Du coté industriel, la
restructuration du spatial européen depuis la création d'EADS Space en
2003 s'est accompagnée d'un plan de réorganisation avec notamment la
concentration des moyens technologiques sur un nombre plus restreints de
site, passant par le transfert de certaines capacités de production. une
démarche visant à optimiser l'utilisation des ressources, à atteindre
une taille critique suffisante et à mieux maîtriser les budgets limités
de la R&D. Premier dommages de cette réorganisation, le transfert de la
production et l'intégration des SPELTRA de Friedrichshafen aux Mureaux.
la seconde étape est aujourd'hui, le transfert de l'intégration de la
VEB de Toulouse à Brême. le 28 octobre 2005, un Airbus Béluga amenait la
dernière case 0006C à Brême chez EADS. Une politique qui vise pour les
clients à réduire les coûts et à l'industriel d'améliorer son
efficacité. Comme les étages supérieurs d'Ariane 5, EPS et ECA sont déjà
fabriqués et intégré à Brème, cela s'simplifie le processus et permet de
tenir les promesses envers les clients. Ce transfert de la VEB ne sera
complet que lorsque les équipes de Toulouse auront effectuer les tous
derniers tests électriques et acoustiques du modèle 0006C.
Depuis 1975, Toulouse,
c'était Ariane. Engins MATRA, MATRA-ESPACE, MATRA-MARCONI-SPACE, ASTRIUM
et EADS ASTRIUM fabrique les cases à équipements d'Ariane depuis 1977.
175 ont ainsi été produites, soit 28 cases AR1 à 3, 116 cases AR4 et 31
cases AR5 toutes versions. Toulouse développait aussi les plateaux ASAP
pour les charges utiles secondaires pour AR4 et5. Toulouse, c'était
aussi les prestations d'assistance technique pour 168 campagnes de vol à
Kourou qui a permit le lancement de près de 240 satellites et 50
passagers auxiliaires. Toulouse, enfin, c'était des équipes avec des
personnes: "Tout a démarré en 2002 avec l'effondrement de la téléphonie
satellite, les constellation Iridium, GlobalStar face au GSM terrestre
dira cet ingénieurs Toulousian. Un marché avec moins de satellite et
moins de lanceurs, on restructure entre brème, Toulouse et les Mureaux.
Toulouse devient l'usine à satellite de télecom, les Mureaux
l'ingénierie et brème, l'usine à lanceur. Après la création d'EADS,
l'équipe "développement" de Toulouse va pour la plupart chez Airbus
(A380, A400) et la production va sur les satellites en 2004. peu iront
en Allemagne."
|
11 janvier V164, Ariane 5 est
transféré en ZL 3 à 10 h 45 pour sa troisième RSL .
13 janvier V164, la troisième RSL (répétition système lanceur) du lanceur
est terminée. Cette revue a permit de valider les procédures de remplissage en
ergols de l'étage ECA ainsi que les opérations de compte à rebours jusqu'à
H-0. Les techniciens et ingénieurs vont maintenant analyser les données
collectées qui permettront de valider la date du tir le 11 février. Le lanceur
est ramené dans le BAF le 20.

3 février, V164, les satellites
Sloshsat/Maqsat B2 sont assemblés à l'adaptateur Ariane 5 qui sera lui même
installé sur l'étage ECA. La partie supérieure du SYLDA est ensuite
monté. Enfin au son sommet est posé le satellite Xtar EUR.
7 février, V164, mise en place
de la coiffe sur le lanceur Ariane 5. La lancement reste prévu pour le 11
février.
8 février, V164, Arianespace
repousse le lancement de 24 heures, lors de contrôles de routine, une anomalie
ayant été découverte sur un équipement sol. le décollage du lanceur V164
est prévu le plus tôt possible entre 19h49 et 21h10, le 12 février 2005.
| LES
CHARGES UTILES DU VOL V164 (8312 kg) |
 |
Le
satellite SLOSHSAT
Flevo (Facility for Liquid Experimentation and Verification in
Orbit) ici en salle blanche à Kourou. C'est un petit satellite expérimental
pour l'étude de la dynamique des liquides dans l'espace. De l'eau
transporté dans le satellite sera filmé afin de comprendre ses
effets sur le contrôle d'attitude des vaisseaux spatiaux. D'une masse
de 128 kg, Sloshsat transporte 33,5 kg d'eau dans un réservoir de 87
litres. Flevo est un programme ESA, les PAys Bas et l'Allemagne.
Originellement, Sloshsat devait voler sur le Shuttle, mais n'ayant pas
trouvé de place, il a été transféré sur Ariane 5. |
 |
MaqSat B2, Maquette
Satellite - Bas 2, 3500 kg, simule un satellite passager et sert de
support technologique pour Sloshsat, les expériences françaises
Boucle-Fluide, DVCAM (caméra filmant les évènements du lancement) et
TMA (Telemetry Assembly), un appareillage de 60 senseurs destinés à
enregistrer des paramètres de vol de l'ECA.
|
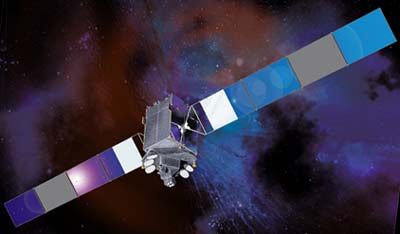 |
Le satellite de télécommunications
XTAR-EUR (3600 kg) est placé dans le SYLDA. Placé en orbite GEO calé par 29°
E, il couvrira une région allant de la côte Est du Brésil au sud-est
asiatique. XTAR, fabriqué par Space Systems/Loral, fournira des services de
communications gouvernementales et militaires, notamment aux Etats-Unis et à
l’Espagne.
|



Transfert du V164 sur la ZL3 le 11
février
ARIANE 5 V164
Le lanceur L521 est transféré
en ZL3 le 11 février dans l'après midi. Le décompte final démarre à T-11 h
30. A T- 5 h 30 commence le remplissage en carburant de l'étage EPC et ECA. La
séquence synchronisé automatique démarrera à T-16 mn. La séquence
synchronisée a pour but essentiel d’effectuer les mises en œuvre ultimes du
lanceur et les contrôles rendus nécessaires par le passage en configuration de
vol. Elle est entièrement automatique et conduite en parallèle jusqu’à H0 -
4 s par deux calculateurs redondés situés dans le Centre de Lancement de l’ELA
3. Les calculateurs effectuent les dernières mises en œuvre électriques
(démarrage du programme de vol, des servomoteurs, commutation alimentation
sol/batteries de vol, etc…) et les vérifications associées. Les calculateurs
effectuent les mises en configuration de vol des ergols et des fluides et les
contrôles associés ainsi que les dernières mises en configuration des
systèmes Sol, à savoir :
- Démarrage de l’injection d’eau dans les carnaux et le guide jet (HO - 30
s.).
- Aspiration hydrogène de mise en froid du Vulcain dans le guide jet (H0 - 18
s.).
- Allumage de l’hydrogène de mise en froid (H0 - 5,5 s.).
A partir de H0 - 4 s le calculateur de bord prend la gérance des opérations
ultimes de démarrage des moteurs et du décollage: il lance la séquence d’allumage
du moteur Vulcain du 1er étage à H0 ; il contrôle les paramètres du moteur
(entre H0 + 4,5 s et H0 + 7,3 s) ; il autorise l’allumage des Étages d’Accélération
à Poudre entraînant le décollage immédiat à H0 + 7,3 s. Tout arrêt de
séquence synchronisée après H0 - 16 mn ramène automatiquement le lanceur
dans la configuration H0 - 16 mn.
Le compte à rebours est
exemplaire, tout les signaux restant au vert jusqu'à 59 secondes du tir prévu
à 20 h 39. Un rouge ELA provoque un arrêt de près de 40 minutes, un
capteur de mesure de pression sur le lanceur ayant donné de mauvaises
indications. Le décompte reprend à T - 16 mn à 21 h 47 pour un lancement à
22 h 03 mn. Il est 22 h 03 mn lorsque Ariane V164 quitte l'ELA 3. Le vol,
propulsé est parfait, les EAP sont largué après 2 mn 21 s de vol, l'étage
EPC continue seul la propulsion jusqu'à 8 mn 47 s. L'allumage de l'étage ECA
équipé d'un moteur HM7B a lieu à 8 mn 57 s. Le lanceur est successivement
acquit par les stations de Natal (Brésil), Ascension, Libreville (Gabon) et
Malindi. Après un fonctionnement "nominal", l'étage ECA est éteint
à T + 24 mn 37 s. XTAR-EUR, la partie supérieure du Sylda et SLOSHSAT sont
séparé à T + 26 et 31 mn, la mission est un succès.
| Pour Ariane 5
ECA V164, les MPS ont été surchargés par l’ajout de 2,2 tonnes de
propergol dans leur segment avant. Chaque MPS pèse désormais plus de 271
tonnes, dont 240 tonnes de propergol. Cette quantité supplémentaire
permet d’augmenter la masse de la charge utile d’Ariane 5 d’environ
400 kg en orbite de transfert géostationnaire.
En parallèle, d’autres modifications ont
été apportées dans un objectif de réduction des coûts et de la masse
du lanceur : au niveau des tuyères réalisées par Snecma Propulsion
Solide, au niveau des systèmes d’accrochage arrière des MPS au corps
central d’Ariane 5 et aussi au niveau du procédé de fixation des
gouttières électriques des EAP qui sont maintenant collées directement
sur les moteurs.
Sur le vol 164 Ariane 521, les tuyères des
EAP, de configuration C, représentent une étape intermédiaire entre les
tuyères qui équipaient précédemment le lanceur et celles, de
configuration D, qui sont actuellement développées et seront utilisées
pour la première fois sur un lanceur Ariane 5 prévu en 2006. « Comme
les futures tuyères, celles d’Ariane 521 comportent un divergent aval
en 2 parties. Sa particularité est que la partie composite dépasse
sensiblement par rapport à la partie métallique. Cette nouvelle
définition permet, à iso performance , de réduire les coûts de
production , ce qui constitue un des objectifs majeurs du Programme Ariane
5.

|
Les paramètres calculés à
l'injection de l'étage supérieure cryotechnique (ESC-A) sont : Périgée :
249,9 km pour 249,9 (± 4) km visés, Apogée : 35 821 km pour 35 918 (± 260)
km visés, Inclinaison : 6,98° pour 7° (± 0,07)° visés. La performance
demandée au lanceur pour le Vol 164 était de 8 312 kg dont 3 772 kg
représentent la masse des satellites XTAR-EUR et SLOSHSAT séparés sur
l'orbite visée. Pour valider la performance du lanceur, la structure MAQSAT
d'une masse totale de 3 496 kg était intégrée au composite supérieur. Surfant
sur la vague de ce succès, Arianespace annonce une nouvelle commande avec
l'opérateur Brésilien Star One pour lancer le satcom Star One C2 en 2007. Ce
sera le 8eme satellite brésilien lancé par Ariane. Le carnet de commande
s'élève maintenant à 40 dont trois ATV pour ISS, trois Soyouz de Guyane et
deux de Baikonour. Jean Yves Legall pense pourvoir lancer 6 Ariane 5 cette
année. Deux autres Ariane 5 ECA partiront de Kourou avant la fin de l'année.
Une embarquera le satellite météo de l'ESA MSG 2 avec un satcom et une autre
un satcom, soit Instar 4A en milieu d'année, soit Galaxy 15, soit Wildblue,
soit Ipstar 1 ou JC Sat 9. Le plus changement est que les clients acceptent
maintenant de voler sur Ariane 5 ECA le plus tôt possible. Le premier vol de l'ATV
est donc repoussé à 2006 laissant son créneau pour un vol commercial.
Désormais, les lancements ne comporteront plus de numéros mais le nom des satellites
à lancer.




| Objet de
toutes les attentions lors du retour en vol d’Ariane 5 ECA, le moteur
Vulcain 2 a été développé et produit sous la maîtrise d’œuvre de
Snecma Moteurs, dans le cadre d’une vaste coopération européenne
rassemblant une quarantaine d’entreprises. Parmi ces sociétés, EADS ST
Gmbh s’est vue confier la chambre propulsive (partie centrale du moteur
qui comprend notamment la chambre de combustion et le divergent) et a
délégué, conformément au contrat passé avec Snecma Moteurs, le
développement et la production du divergent à Volvo Aero Corporation.
Techspace Aero, une autre société du groupe Snecma, était en charge de
vannes cryotechniques, et Avio devait réaliser la turbopompe à oxygène.
Snecma Moteurs était quant à elle directement responsable du
générateur de gaz, de la turbopompe à hydrogène et de l’intégration
de l’ensemble du moteur, réalisée sur son site de Vernon (Normandie).
42 essais, 19500 secondes de fonctionnement
La rupture du divergent du moteur Vulcain 2
ayant été à l’origine de l’échec du premier vol d’Ariane 5 ECA
(Vol 157, le 11 décembre 2002), Snecma Moteurs, aidé de ses partenaires,
a mobilisé toutes ses compétences spatiales et aéronautiques pour
remettre le lanceur en vol dans les meilleurs délais. Equipes
intégrées, calculs à la limite du savoir-faire mondial, expertises et
modélisations on été au cœur de cet effort géré comme un véritable
programme de développement.
Du côté des essais, 42 ont eu lieu au
total, entre janvier 2003 et juillet 2004, en France et en Allemagne,
accumulant plus de 19500 secondes de fonctionnement des moteurs Vulcain 2.
Trois moteurs ont été utilisés et sept divergents ont été testés,
avec une configuration qui a évolué.
Le divergent du Vulcain 2, qui n’avait
pas résisté aux très fortes contraintes subies lors du Vol 157, a été
entièrement revu. La nouvelle version - qualifiée, comme le moteur, en
juillet 2004 - comprend trois modifications principales. Pour la tenue
mécanique, une « jaquette » en alliage base nickel (2,28 mm d’épaisseur
et 40 cm de haut) est soudée à l’extérieur de la partie haute du
divergent (avant le tore de réinjection des gaz de turbines). Elle est
dotée de raidisseurs axiaux pour reprendre les mouvements de
fléchissement. De plus, la partie basse du divergent est renforcée par
des raidisseurs annulaires. Le divergent a également été raccourci de
quelques centimètres.
Dans le domaine thermique, deux autres
modifications majeures ont été apportées. D’une part, le débit d’hydrogène
liquide a été augmenté dans les circuits de refroidissement (la paroi
de la partie supérieure du divergent est constituée de 288 tubes
hélicoïdaux à section rectangulaire soudés les uns aux autres, dans
lesquels circule l’hydrogène liquide). A cela s’ajoute une
amélioration de la procédure de soudage, introduite par Volvo Aero, qui
renforce la tenue thermo mécanique de ces circuits.
D’autre part, une barrière thermique de
quelque dizaines de centimètres de hauteur en oxyde réfractaire (zircone
yttriée), déposée par plasma, est appliquée à l’intérieur du
divergent. Elle permet de rester en dessous des seuils thermiques qui
entraîneraient des modifications dans la structure interne de l’alliage.
Cette technologie est directement dérivée de celle utilisée par Snecma
Moteurs sur la chambre de combustion des moteurs M88-2 de l’avion de
combat Rafale. Mais elle est ici appliquée pour la première fois sur une
structure tubulaire.
Toutes ces adaptations ont permis de
renforcer le divergent, partie du moteur la plus exposée aux efforts
rencontrés en vol. D’autres améliorations du moteur Vulcain 2 - qui
avaient été prévues avant décembre 2002 pour les prochains vols - ont
aussi été introduites. « La turbopompe oxygène a été renforcée, c’était
une amélioration prévue pour plus tard, mais nous en avons profité pour
anticiper », explique Pascal Rallu, « et nous avons également
fiabilisé l’allumage de la chambre et augmenté la capacité du bloc
système de contrôle de roulis chargé de compenser un éventuel couple
de roulis. » Autant d’éléments destinés à accroître la robustesse
d’ensemble du moteur et donc la fiabilité du lanceur.
Techspace Aero conçoit et fabrique des
vannes destinées au moteur Vulcain 2. Ces équipements ont trois grandes
fonctions : la mise en froid, l’alimentation et la régulation du moteur
à propulsion liquide.
Sur les huit vannes de Techspace Aero qui
équipent Ariane 521, sept sont des vannes cryotechniques. Elles
fonctionnent en présence de fluides portés à - 183°C pour l’oxygène,
- 253°C pour l’hydrogène et - 269°C pour l’hélium. Deux sont des
vannes d’injection des ergols liquides (oxygène et hydrogène) dans la
chambre de combustion : ouvertes 1 à 2 secondes avant le point H0 (“ H
zéro ”) d’allumage du moteur Vulcain 2, elles marquent un instant
clé dans la séquence synchronisée du lanceur. On compte aussi trois
vannes de mise en froid du moteur : l’une est branchée sur la ligne
oxygène, l’autre sur la ligne hydrogène et la troisième met en froid
les roulements d’une turbopompe. Enfin, au niveau du sous-système à
hélium liquide de l’Etage Principal Cryotechnique (EPC), on trouve une
vanne de remplissage de l’hélium et une vanne de sécurité.
La huitième vanne fonctionne, elle, à des
températures bien plus élevées : jusqu’à plus de 1000°C. Il s’agit
d’une vanne de gaz chauds placée juste en amont de la turbopompe à
oxygène. Son rôle : régler l’admission d’un mélange gazeux
composé de vapeur d’eau surchauffée et d’hydrogène, pour entraîner
la turbine et assurer le point de fonctionnement du moteur Vulcain 2. C’est
une vanne à papillon qui fonctionne un peu selon le principe de l’admission
d’air d’un carburateur de voiture. C’est en fait la seule vanne qui
a été modifiée pour le nouveau moteur Vulcain 2. Elle a été
complètement redimensionnée pour supporter des pressions plus élevées
et rendre beaucoup plus précise la position du papillon à l’intérieur
de la vanne. Résultat : le rapport du mélange gazeux est optimisé au
cours de la trajectoire du lanceur. Le moteur Vulcain 2 est passé d’un
à deux points de fonctionnement, ce qui permet d’améliorer la
trajectoire en termes de flexibilité et de consommation, et de gagner 130
kg de charge utile (sur les 1300 kg gagnés au total grâce aux
modifications au niveau de l’EPC).
Au final, le nouveau moteur Vulcain 2 contribue
pour près d’un tiers à l’augmentation de charge utile offerte par
Ariane 5 ECA par rapport à l’Ariane 5 Générique. Le Vulcain 2
délivre une poussée de 1350 kN (130 tonnes) dans le vide, contre 1150 kN
(110 tonnes) pour le moteur Vulcain de la génération précédente.
webmag.safran-group.com, février 2005

On
reconnaît le Vulcain 2 à l’absence des lignes d’échappement le long
du divergent : les gaz éjectés, après combustion dans le générateur
de gaz et entraînement des 2 turbines, sont ré-injectés dans la chambre
de propulsion au niveau du tore appelé TEG que l’on voit au milieu du
divergent. La grosse ligne au dessus du
TEG est une ligne d’échappement turbine, la petite qui va jusqu’en
bas du divergent est la canalisation d’éjection de l’huile qui sert
à actionner les vérins hydrauliques du moteur (concept dit à huile
perdue). A l’intérieur du divergent du Vulcain, on distingue sur les 20
cm les plus bas une zone blanche : il s’agit d’une protection
thermique spéciale, revêtement permettant au matériau (Inconel) de
tenir thermiquement dans cette zone qui est la plus chaude.

L'allumage
complet du Vulcain prend environ 5 secondes, suivi d'environ 1 seconde
pour vérifier que tous les critères de bon fonctionnement du moteur sont
corrects. La poussée passe de 10 à 100% en 800 ms environ (contre 5
secondes pour un turboréacteur), ce qui est extrêmement contraignant. Au
moment du plein allumage, on note une forte réaction latérale du moteur
suite à une excitation qu'on appelle recollement de jet. Quand le jet
s'accroche dans le divergent, il ne le fait pas forcément de façon
symétrique ce qui entraîne une intégrale de pression plus forte d'un
côté que de l'autre. Les efforts résultants dynamiques (environ 10 Hz)
peuvent être extrêmement élevés et casser les ferrures d'ancrage du
moteur (exemple du LE7A japonais) ou endommager les vérins hydrauliques.
C'est un phénomène très complexe à modéliser et à maîtriser.
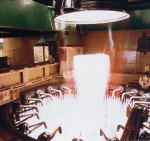
Sur cet allumage d'un
Vulcain 1, on voit très bien le disque de Mach et le déluge d'azote
gazeux,
le fameux tore azote, qui crée un genre de vortex pour évacuer plus vite
encore
les gaz de mise en froid du divergent et de démarrage du moteur.
On
voit bien le pincement du jet dû à sa sur-détente du divergent, et le
disque de Mach associé. Il résulte du
pincement du jet en sortie de divergent dû à la mauvaise adaptation du
divergent pour le sol : le Vulcain est optimisé pour fonctionner
dans le vide, donc sans pression atmosphérique. La pression de sortie est
alors de l’ordre de 200 mb. Au sol, avec 1 bar de pression atmosphérique,
le jet est pincé ce qui génère cette zone de concentration appelée
disque de Mach.
|
21 février, début de la
campagne de lancement V166 à Kourou avec l'arrivée des containers enfermant le
lanceur Ariane 5 , première GS qui doit mettre en orbite à la mi avril deux
satellites, dont Syracuse pour la DGA et Telkon pour l'Inde.

18 mars, Arianespace annonce
qu'elle lancera le satcom de SES AMC 18 en 2006. Concernant la campagne V166, il
s'avère qu'un des satellites devant être lancé par la première Ariane
5 GS (Syracuse 3A) ne sera pas prêt à temps pour un tir le 14 avril. Le vol serait
repoussé à juin en même temps que le troisième vol de l'ECA. En fait
le calendrier officiel dépendra de la disponibilité des charges utiles.
23 mars, Arianespace
lancera 7 charges utiles dans les 5 prochains mois avec Ariane 5. Quatre
tirs sont planifiés avant la fin de l'été, dont trois avec Ariane 5G.
Actuellement deux campagnes sont en préparation au CSG V166 et 167.
Compte tenu du report de V166 à mai ou juin, Arianespace devra réaliser 4 tirs
avant septembre, ce qui semble très ambitieux comme calendrier. D'autre
part, lors d'une réunion à Washington, les trois partenaires du "Launch
Services Alliance" parlaient d'une voix commune sur la possibilité
de moduler les lancements sur leur trois lanceurs différents. Mis à part
AMC 18, Arianespace devrait lancer un Skynet 5 britannique en gardant un
Zenith Sea Launch en secours. Eutelsat doit aussi confier son "HotBird
7A" à Ariane avant la fin de cette année ce qui obligerait
Arianespace a modifié considérablement son calendrier. La nouvelle
politique de la société ferait donc maintenant passer les nouveaux
clients et les revenants (comme AMC de SES) en premier par suite de
l'indisponibilité de lanceurs.
6 avril, Arianespace
confirme que le vol V166 est finalement annulé et c'est une Ariane 5 ECA
qui volera à la mi juin avec à son bord le satellite IpStar. Le lanceur
Ariane est victime d'un banal problème de disponibilité de satellite
finalement. Les données relatives au vol 164 sont presque toutes analysé
et aucun problème n'empêchera un autre vol vol cet été. IpStar d'une
masse de 6800 kg sera le seul passager du vol 167 prévu entre le 17 et le
24 juin. La campagne de vol 166 est donc suspendue et ne reprendra que
lorsque le satellite Syracuse (3700 kg) sera livré à Kourou. Si le
satellite ne devait pas être livré à temps, Telkon (1930 kg) sera
envoyé en orbite avec Spaceway 2 (6100 kg) ou Galaxy 15 (1760 kg).



Montage du lanceur V166
21 avril, Le lanceur V166 est maintenant complet avec
l'étage EPC, les deux EAP, la case VEB et l'étage EPS. V166 est
maintenant prévu pour le 28 juin.
2 mai, début de la
campagne du lanceur Ariane 522 V167 avec la mise en place de l'étage EPC
sur la table de lancement. Les EAP suivent le 4.

2 mai, transfert du lanceur
V166 du BIL au BAF.

10 mai, arrivée du
satellite Syracuse 3-A à Kourou. Ce satellite sera mis en stockage en
attendant un lancement soit sur V166 soit sur V167. Syracuse devait être
lancé avec Telkom 2 sur V166 en avril. Le lancement a été reporté au
28 juin, sans charge utile assigné pour le moment.

11 mai, V167, mis en place
de l'étage ESC A et de la case à équipement le lendemain.
16 mai, le lancement du
satellite militaire français Syracuse 3 étant assujetti à des
décisions politiques, c'est V167 qui partira en premier le 24 juin avec
dans sa coiffe deux satcoms, Spaceway 2 (6100 kg) et Telkom 2 (1930 kg). Ce vol sera aussi le
troisième d'une Ariane 5 ECA.
24 mai, V167, arrivée du
satcom Spaceway 2 à Kourou.
1er juin, Arianespace
annonce qu'elle lancera une Ariane 5 ECA le 25 juin prochain entre 0 h 03
et 0 h 36 TU. A bord de ce vol V167, deux satcoms, Spaceway 2 (6,116 kg)
et Telkom 2 (1,975 kg).

Telkom 2 à Kourou
6 juin, V167 un problème sur le
satellites Telkom 2 repousse le lancement de la troisième ECA. C'est
la première Ariane GS qui partira dans la nuit du 7 au 8 juillet avec le
plus gros satcom du monde, IpStar (6735 kg). Le 19 juin, le lanceur est
mis en sommeil.
Le 1er juillet, Ipstar est recouvert de sa coiffe.


Le 4 juillet, Arianespace annonce que le lancement de la première Ariane
5GS (523) est prévu le 11 juillet entre 06h40 et 08h40 TU, pour mettre
sur orbite THAICOM 4 (IPSTAR) pour l'opérateur thaïlandais SHIN
SATELITTE Plc. Arianespace lancera aussi fin août début septembre le
satellite militaire français Syracuse 3A à bord d'une AR5 GS. D'ici la
fin de l'année, 5 lancements sont programmés avec des Ariane 5 G. En
2006, seules 6 AR5 ECA seront lancés de Kourou, en plus de l'AR5 EVS de
l'ATV.
11 juillet, Arianespace
annonce un retard de quelques jours pour le lancement de V166.
18 juillet, Arianespace
repousse de nouveau de quelques jours le lancement du vol V166 avec le
satcom Ipstar. Une nouvelle date sera annoncée dans la semaine du 25
juillet. Le satellite n'est pas en cause, mais l'étage EPS du lanceur
qu'il va falloir changer. Une date sera annoncé prochainement mais les
équipes visent un tir vers mi août.
| ARIANE
523 GS |
| Ariane
523 est la première version GS du lanceur européen.
C'est en 1998 avec le programme
Ariane 5 plus qu'Arianespace et l'ESA avaient décidé d'améliorer
la filière Ariane 5 afin d'augmenter ses performances en orbite.
Cette augmentation de performances impliquant de rendre l'étage EPS
rallumable en vol (AR5 EV) et de développer un étage cryogénique
(AR5E CA), rallumable en vol (AR5E CB).
Avec Ariane 5 de base, dite
version G (Générique), la charge utile est de 5360 kg en GTO,
lancement double pour les premiers vols, soit 500 de moins que celle
prévue. En 2002, elle atteint 6030 kg en GTO, lancement double
(6700 en lancement simple) après les quelques améliorations
apportés au lanceur.
Les premières modifications d'Ariane
5 se font dans le cadre du programme "Evolution". Elle se
concentre sur le composite inférieur avec l'augmentation de la
capacité en ergols de l'étage EPC (+ 15 t), l'augmentation de la
poussée du moteur Vulcain 1 (+ 20 %) et la réduction de la masse
des boosters EAP. La charge utile passe alors à 7350 kg en GTO, en
lancement double (+ 1000 kg).
Les améliorations du composite
supérieur se font dans le cadre du programme "Plus" avec
le développement de l'étage versatile rallumable en vol EPS et de
l'étage cryogénique ESC A et B. AR 5 ECA est aussi équipé d'un
nouveau moteur Vulcain amélioré, le Vulcain 2. La charge en GTO
lancement double atteint 8760 kg.
La version de base "G"
et a volé 13 fois (501 à 513). Avant de passer à la version ECA,
Arianespace avait décidé de "tester" certains éléments
du composite inférieurs sur la version G+. Les trois G+ construites
étaient équipées d'un moteur Vulcain 1, d'EAP de première génération
avec toutefois quelques améliorations, une case à équipement
allégée et un étage EPS avec réservoirs allongés. La capacité
en orbite passe à 6275 kg en GTO, lancement en double, soit plus
200 kg.
Après l'échec du premier ECA
(vol 517), Arianespace s'est retrouvé sans lanceur, puisque les
fusées en production étaient toutes des ECA. Il a été décidé
de modifier quelques AR5 ECA en version de base G afin de continuer
les tirs en tenant compte des modifications apportés par l'échec
du 517. Ces "nouveaux" lanceurs, les AR5 GS (Générique
Standard) sont désormais la référence de base pour
Arianespace.
Ce sont des lanceurs avec des
éléments du lot P2, l'étage EPC Hybride (H173), les EAP 241, l'EPS
rallumable en vol, la case à équipement (avec SCA externe). Le
moteur reste un Vulcain 1 avec quelques éléments du Vulcain 2. Sa
performance est légèrement inférieure à la G+, soit 5780 kg en
GTO en lancement double. |
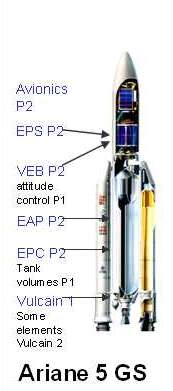
|
24 juillet, Arianespace annonce
le lancement de V166 le 11 août prochain. L'étage EPS a été changé à la
suite de problèmes découverts lors de son remplissage en ergols.
9 août, V166 transfert du
lanceur en ZL 3. Le lancement est prévu le 11 à 6 h 39 TU.

ARIANE 5 V166 (IPSTAR)
Le compte à rebours final
démarre à 19 h 09 TU le 10 août. Suit le remplissage de l'étage EPC à
1 h 49 TU. A T-7 mn démarre le séquence automatique. A H-15 s, le compte
à rebours est arrêté, suite à un rouge sur l'ELA. Selon Jean Yves
Legal il s'agirait d'une mauvaise lecture de données des allumeurs de la
table de lancement. Un problème similaire avait repoussé le tir V157 en
2002.
A 8 h 17, le compte à rebours reprend à T-7 mn. 8 h 20, Ariane 5 quitte
sa table de lancement. Le vol est "nominal" avec le largage des
EAP à T+ 2 mn 20 s et l'allumage de l'étage EPS à T + 10 mn. 8 h49,
après 28 mn et 29 secondes, Ipstar se sépare du lanceur.


25 août, début
de la campagne de lancement de V168. Le lancement est prévu fin septembre
avec le satellite militaire français Syracuse 3A et le satcom Galaxy 15.
2 septembre, V168, la case à équipement VEB est hissé sur le
lanceur. Arianespace va lancer 3 Ariane 5 avec 6 charges utiles d'ici
la fin de l'année. Pour 2006, 6 missions sont prévues.
Le 6 septembre, Arianespace signe un contrat de lancement avec Shin
Satellite pour le lancement du satellite Thaicom 5 en 2006. D'une masse de
2800 kg, il est le 5eme satellite lancés par Ariane depuis 1993 et
remplacera au dessus du pacifique les deux premier Thaicom.

16 septembre, V168, transfert du
lanceur vers le BAF.


24 septembre, V167,
arrivée du satcom Telkon 2 à Kourou.
24 septembre, V168, Arianespace
annonce un report de quelques jours du lancement V168 suite à un
problème sur le lanceur. Le lancement prévu le 29 septembre avait déjà
été repoussé de 7 jours. Le 28, elle annonce que V168 s'envolera dans
la nuit du 13 au 14 octobre entre 22h32 et 23h56 TU.


Remplissage de Syracuse le
28 septembre et mise en place sur l'étage EPS le 7 octobre


ARIANE 5 V168 (SYRACUSE - GALAXY
15)
Le lancement a lieu le 13
octobre à 22 h 32 Tu après un décompte sans histoire. Les boosters EAP
sont largués à T+ 2 mn 23 s, suivit de la coiffe à T + 3 mn 30 s.
L'étage EPC assure seul l'ascension du lanceur jusqu'à T + 10 mn 8s.
L'étage supérieur EPS prend le relais pendant 17 minutes jusqu'à T + 27
mn. Syracuse se sépare du
composite à T + 29 mn suivit de Galaxy 15 à T + 36 mn. Ils seront calés
en orbite GEO par 47° O et 133° E. C'est le 3eme tir cette année. Le
prochain, V167 est prévu en novembre avec une Ariane ECA et deux satcoms.

17 octobre, V167, reprise de la
campagne de lancement.
20 octobre, V167, transfert du
lanceur du BIL au BAF. Le lancement des satcoms Spaceway 2 et Telkon 2 est
prévu le 9 novembre.


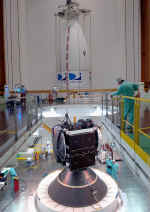
Transfert du Ariane 522, intégration
de Spaceway 2 et mise en place de Telkon sur l'ACU le 28 octobre



Mise en place de Spaceway
sur le SYLDA et mise en place de la coiffe le 31 octobre
1er novembre, V167, Arianespace
annonce que le lancement est prévu le 10 novembre entre 23 h 44 et 00 h
29
TU.
10 novembre, V167, Arianespace repousse le
lancement de 48 heures "afin de procéder à des vérifications complémentaires".
Début de la campagne de lancement du lanceur V169.

12 novembre, V167, le lancement
est de nouveau reporté "à la suite d'une difficulté intervenue dans la
mise en oeuvre du lanceur", annonce Arianespace. En fait il s'agit d'un
problème de tenue en pression d'inertage azote du caisson hydrogène ESC dans
le mât de la table qui a causé un arrêt chronologie sur rouge Ensemble de
Lancement vers H0 - 4h.
13 novembre, la tentative de
lancement a de nouveau été arrêté à cause d'un problème d'environnement thermique inter-étages
EPC/ESC. La chronologie a été arrêtée vers H0 - 8h et le lanceur va être transféré au BAF en fin de journée pour investiguer et réparer l'anomalie.
un flexible qui amène l'azote et l'hélium au lanceur a souffert du vent,
provoquant une fuite. Il doit être changé dans le bâtiment d'assemblage
final.



ARIANE 5 V167 (SPACEWAY 2 -
TELKON 2)
Le lancement
a lieu le 16 novembre à 23H46 GMT après un compte à rebours sans
problème. Le vol propulsé est "nominal" et permet 34 mn plus
tard de libérer les satcoms Spaceway 2 et Telkon 2.
Le satellite Spaceway-2, 6100 kg au décollage, est l'un des plus gros
satellites de télécommunications du monde. Construit par Boeing
Satellite Systems, sa mission sera entièrement consacrée à la
transmission d'émissions de télévision haute définition en directe aux
Etats-Unis pendant plus de
12 ans.
Telkom-2 doit assurer des services de téléphonie, ainsi que des
transmissions d'images et de données pour l'Asie
du Sud Est et du sous-continent indien pour l'opérateur PT.Telekomunikasi
Indonesia Tbk.
Il s'agissait de la troisième mission d'une Ariane-5 dans sa version la
plus puissante, et de la quatrième d'une Ariane depuis le début de
l'année 2005.C'est aussi la 168e mission d'une fusée Ariane depuis leur
mise en service en décembre 1979.

17 novembre, mise en place sur la table de
lancement n°1 de l'étage EPC du lanceur 525. Ariane devra lancer le
satellite indien Insat 4A et le satellite météo MGS 2. Le satellite est arrivé au Kourou le 21 juin
dernier et mis en stockage pendant 117 jours. le 31 octobre a commencé sa
préparation, la campagne de tir à démarré le 10 novembre.



Le satellite météo de
l'ESA MGS 2 et Insat 4A dans leur bâtiment de préparation à Kourou
Le 23 novembre, hissage de
la case à équipement et de l'étage EPS.





Remplissage MSG 2 le 29
novembre au SA
Le 8 décembre, V169,
transfert du lanceur du BIL au BAF.


Insat 4 en salle blanche



14 décembre, mise en coiffe
d'Insat 4B. A droite MGS 2.
13 décembre, Arianespace
et l'ESA signent le contrat de lancement des télescopes Herschel et
Planck pour le premier semestre 2008. Les deux sondes seront lancés par
une ECA et injecté au point de Lagrange L2 à 1,5 millions de km de la
terre.
Hershel aura deux objectifs principaux observer l'univers froid à la
recherche de la formation d'étoiles et de galaxies et étudier la composition
chimique des atmosphère autour des corps célestes. Le miroir du
télescope mesure 3,5 m de diamètre, le plus gros jamais lancé.
Construit par Alcatel Alenia Space, il pèse 3300 kg au lancement.
Planck analysera les radiations cosmiques laissées lors de la formation
de l'univers. Comme Hershell, il est construit par Alcatel Alenia Space et
pèse 1800 kg au lancement.
21 décembre, le lanceur
525 est amené en ZL 3. La fenêtre de lancement de 28 mn s'ouvre à 23 h 33 heure de Paris.


ARIANE 5 V169 (MSG 2 -
INSAT 4A)
Le lancement
a lieu le 21 décembre à 21 h 33 TU après un compte à rebours sans
problème. Le vol propulsé est "nominal" et permet 29 mn plus
tard de libérer les satellites indien Insat 4 construit par l'ISRO (3080
kg et 7 mn plus tard de MSG 2 construit par Alcatel Alenia Space (2030
kg). Insat 4A est le 11eme satellite indien lancé par Arianespace et MSG
est le 6eme Meteosat lancés par Arianespace depuis 1981 et géré par
Eumetsat depuis Darmstadt en Allemagne.
Il s'agissait de la 21eme Ariane 5 de série et de la 5eme Ariane depuis le début de
l'année 2005.C'est aussi la 169e mission d'une fusée Ariane depuis leur
mise en service en décembre 1979.

| Le vol
525 est le dernier vol d'une série de 5 où le CNES a pu observer
et étudier la trajectoire de l'étage EPC après sa mission. Avec
Ariane 5, l'impact de l'étage EPC s'est rapproché des terres
émergées, alors qu'avec Ariane 4, les étages retombaient en des
endroits très éloignés des terres émergées. Les contraintes
pour les populations, l'environnement détermine une trajectoire
pour Ariane 5 qui engendre une perte de ses performances. De plus
selon les versions du lanceur, son orientation et sa vitesse au
moment de la séparation influe sur sa trajectoire de retombée et
la zone d'impact. De puis 10 ans, la trajectoire de l'EPC fait
l'objet d'études systématiques (518, 521 et 525).
La trajectoire de l'EPC est calculée
par des logiciels et matériels traditionnels, mais aussi observée
in situ par des moyens aéroportés comme l'avion Zero G de
Novespace. A bord de l'A300, la trajectoire est suivie par des
radars VHF et filmée en vidéo. La vidéo permet de caractériser
le mode de rupture de l'étage, d'observer la phase de passivation
(dépressurisation de l'étage) pendant laquelle l'étage tourne sur
lui même. L'observation permet de "voir" le nombre et la
taille des débris produits lors de la rentrée de l'étage et leur
impact au sol. Lors des derniers vols, l'observation a confirmé les
prévisions. L'étage cède sous la pression aérodynamique, sans
exploser. L'étage se casse en deux, mais retombe dans une zone
relativement restreinte par rapport aux sauvegardes mises en
place.
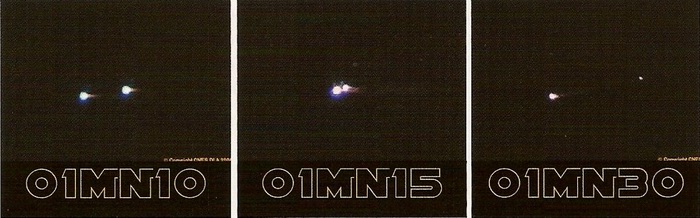
La première photo est
prise au moment de la rupture de l'étage, 1'10" après le
début de la rentrée atmosphérique à 120 km d'altitude. Les deux
secondes se passent après. tout va très vite, l'EPC rentre dans l'atmosphère
à la vitesse de 7000 m/s.
Le prochain contrat pour la DLA
(Division des Lanceurs Ariane) sera l'observation de l'étage EPS
après la mission ATV. |
|
Date
|
Vol
|
Lanceur
|
Satellites
|
Commentaires |
| |
| 12/02/2005 |
V164 |
AR5
ECA
521 |
XTAR-EUR
(Espagne)
Sloshsat FLEVO |
Vol
de démonstration AR5 E.
Premier vol EAP 241 (+2500 kg sur le segment S1)
|
| 11/08/2005 |
V
166 |
AR5GS
523 |
IPSTAR
(Thaillande) |
Première
AR5 GS
Le plus gros satcom du monde 6735 kg |
| 13/10/2005 |
V
168 |
AR5
GS
524 |
Syracuse
3A (3500 kg France) +
Galaxy 15 (1760 kg) |
|
| 16/11/2005 |
V
167 |
AR5
ECA
522 |
Spaceway
2 (6100 kg) +
Telkom 2 (1975 kg) |
|
| 21/12/2005 |
V169 |
AR5
GS
525 |
Insat
4 (3200 kg) +
MSG 2 (2100 kg) |
La
dernière AR5 GS |
| |
|





